Les fantômes des accords de Pays Tiers Sûrs
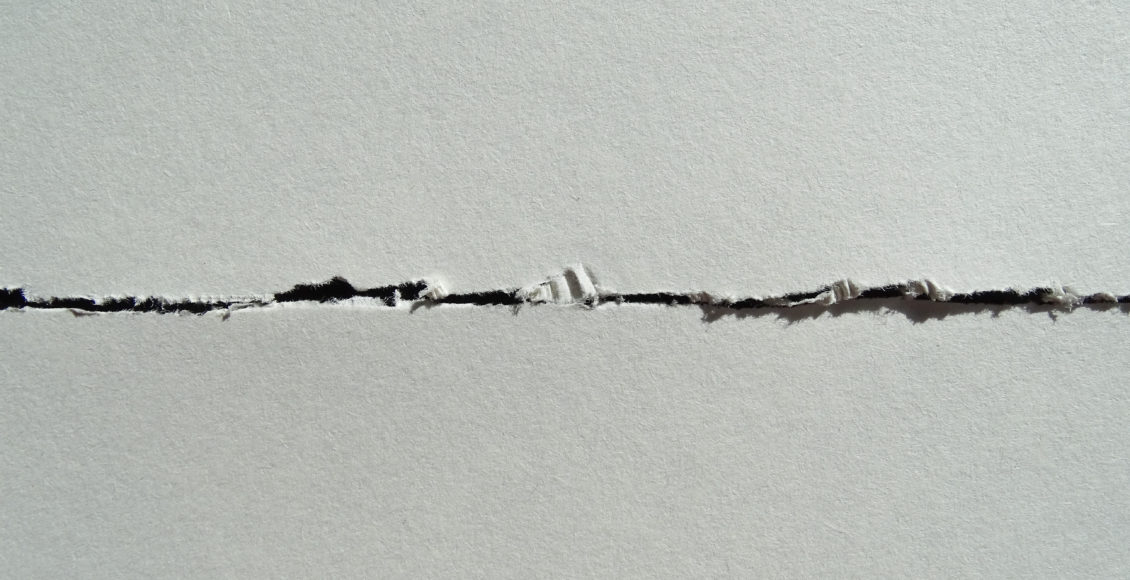 -Diane Robert
-Diane Robert
Disclaimer: À la suite des signatures des Accords de Coopération sur l’Asile (ACA), qualifiés informellement «Accords de Pays Tiers sûrs» avec le Guatemala, le Salvador et le Honduras, le gouvernement des États-Unis aura la capacité légale de déporter des demandeurs d’asile arrivant à sa frontière vers l’un de ces trois pays. Les nationaux d’un pays ne pourront cependant pas être renvoyés vers le leur. Par exemple, une personne du Guatemala ne pourra pas être sujette à l’accord avec le Guatemala, mais pourra l’être avec le Honduras ou le Salvador. Actuellement, déjà près de 200 personnes ont étés déportées vers le Guatemala en accord avec l’ACA. Les réalités politiques et sociales de ces trois pays, en proie à la violence urbaine et la corruption, remettent en doute l’efficacité et la légitimité de tels accords. Cet article tente de dépeindre l’impact humanitaire de ces accords à travers la perspective d’un migrant salvadorien en quête de sécurité. Il s’inspire du nouveau journalisme afin de relater de manière fictive son périple migratoire vers les États-Unis. Cet article traite ainsi de l’aberration, de l’absurdité et de la barbarie relatives à l’implémentation de ces accords.

El Salvador. La peur marquait chacun de mes pas.
Je dois fuir. Fuir cette mort qui me poursuit. Quelle ironie que je doive me sauver de ce pays dont le nom signifie «Le Sauveur». Les gangs de rues (maras) règnent ici en maîtres, notamment la Mara Salvatrucha (MS-13) et Calle 18, et rivalisent pour l’emprise territoriale et le contrôle d’activités illicites. Ils ont converti notre terre en l’une des plus violentes au monde. La mort empeste les rues autant que pendant la guerre civile qui a marqué notre jeunesse des années 1980. C’est depuis ces affronts entre le Front Farabundo Martí de Libération Nationale (FMLN) et l’armée gouvernementale, que les gangs ont affirmé leur pouvoir. Ce qui a changé, ce sont les morts. Hier encore, mon voisin José Quintanillo recevait un avertissement lui ordonnant de payer ses $500 dûs de «loyer» sans quoi il serait exécuté. Son stand de nourriture ne paye pourtant pas de mine, mais il est sur le territoire de la mara : la loi du plus fort s’impose, c’est comme ça.
Désormais, le narcotrafic s’en mêle. Il se sert des maras comme moyen d’acheminement de la drogue et en échange, ils pourront à leur tour commercialiser celle-ci sur leur territoire. Un à un, les habitants disparaissent. Après s’être fait séquestrée, violentée et terrorisée par six individus, ma belle-sœur Dayana a réussi à s’échapper. Je ne l’ai jamais revue depuis… Ce matin, en me levant, je me demande encore si moi aussi je deviendrai fantôme de cette nation avant la tombée de la nuit.
Alors je fuis. Changer de région ne saurait être suffisant, dans un si petit pays. En arrivant dans une nouvelle ville, la Mara locale me demandrait d’où je viens et en découvrant les raisons de mon départ, ils me tueraient inévitablement.
Ma destination est la survie.
Tapachula. La peur caressait chacun de mes pas.
Après avoir traversé le Guatemala, c’est la capitale mexicaine de l’exile, «Tapachula», qui découvre mon ombre encombrée d’illusions. Là, je retrouve d’autres spectres démunis, miroirs lugubres de mon existence. Au détour d’un marché, je rencontre Lorena qui a fui le Honduras avec sa famille quelques semaines auparavant. Ses enfants garderont à jamais le souvenir d’une séquestration longue de deux semaines, séparés de leur mère alors qu’elle se faisait abusée et violentée dans une pièce adjointe. Quinze jours après son arrivée, elle avait aperçu un de leurs ravisseurs à Tapachula. Depuis, ils vivent confinés dans une résidence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Rester ici et déposer ma demande d’immigration m’exposerait à ces mêmes risques. D’autant plus que le centre de détention d’immigration reçoit trois fois le nombre de personnes qu’il ne peut accueillir. La mort à ma porte, je ne peux m’abandonner au hasard d’une demande en attente.
Ma décision est prise. Je traverserai le Mexique en espérant pouvoir, à terme, découvrir la cage dorée nord-américaine.
Mexique. La peur soulignait chacun de mes pas.
Le Plan Frontera Sur (Plan de la Frontière Sud) établi en 2014 par le président Enrique Peña Nieto devient un obstacle additionnel de mon périple. Si, en théorie, le plan doit permettre au gouvernement de « protéger la sécurité et les droits des migrants », en pratique, il ne fait que dévier nos routes migratoires, nous condamnant à arpenter des sentiers toujours plus dangereux. Le dos de La Bête est désormais dénudé depuis l’implémentation de mesures pour nous dissuader de s’y hisser, comme son accélération dorénavant démesurée. Pourtant, si cela nous ralentit et nous expose à de nouveaux dangers, cela ne nous arrête pas. Nous n’avons plus le choix que d’avancer. C’est l’espoir de vivre ou la certitude de mourir. Ces mesures de «protections» profitent néanmoins à d’autres gangs. Le tarif est clair : $100 pour monter sur le toit du convoi et poursuivre sa route, autrement il faut continuer le chemin à pied ou en barque. Je fais le choix de marcher. À pied, les chances d’arriver au bout de cette traversée s’évaporent peu à peu sous le soleil mexicain. Notre vulnérabilité est le fond de commerce des criminels du pays, mais également la dernière chose qu’il nous reste. Presque tous avons souffert d’agressions : nos ravisseurs occasionnels nous dépouillent du peu d’argent qu’il peut nous rester. En passant près de Chahuites, Oaxaca, je découvre quelques trophées funestes de criminels locaux : des sous-vêtements féminins accrochés aux barbelés. Tragiques symboles de souffrances quotidiennes.
Frontière américano-mexicaine. La peur pénétrait chacun de mes pas.
Le mur m’ouvre ses bras.
Je dois attendre du côté hispanophone de la frontière le temps que ma demande d’asile soit étudiée, le plan «Quedate en Mexico» («Reste au Mexique»), implémenté depuis 2019 le requiert. Ce décret révèle l’absurdité de ma situation et la contradiction des politiques migratoires. Nous sommes contraints de rester dans des régions, notamment Tamaulipas, dont le risque est classé Niveau 4 par le Département d’État des État-Unis – au même titre que l’Afghanistan, la Syrie, la Corée du Nord ou le Yémen. Ironiquement, ce plan nous expose à ces même dangers desquels les États-Unis cherchent à protéger leur population.
Alors j’attends. Je reconnais les mêmes visages angoissés et la même résilience qu’à Tapachula. Cubains, Salvadoriens, Guatémaltèques, Honduriens, Nicaraguayens, Vénézuéliens… Une communauté soudée par la désillusion, la peur et l’aspiration à un avenir supportable. Tous attendent. Un mois, un an. Le temps qu’il faudra pour qu’un juge migratoire détermine la validité de nos demandes.
Tassé dans ma masure provisoire, je prends connaissance de ce pays qui me déteste avant même de me connaître. J’apprends les modalités de l’Accord sur le droit d’asile, que les autorités ne veulent nommer «Accord de Pays Tiers Sûrs» entre les États-Unis et le Guatemala. Le principe est simple. Une personne demandant l’asile aux États Unis peut être déportée vers un «Pays Tiers» – ici, le Guatemala – qu’il aurait traversé au cours de son périple migratoire. Des accords similaires ont également été mis en place avec le Honduras et le Salvador. Néanmoins, le principe de non-refoulement interdit la déportation des demandeurs d’asile dans un « territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Un pays tiers doit également être dans la capacité d’assurer la sécurité des demandeurs d’asiles. C’est pourquoi l’octroi de ce statut au Guatemala suscite des inquiétudes. J’apprends que le Président Trump se félicite de « mettre fin au business des coyotes et des trafiquants ». Il affirme qu’il garantira « la sécurité aux demandeurs d’asile légitimes » et qu’il « mettra fin aux fraudes à l’asile et aux abus du système ». J’apprends enfin que je suis refusé d’asile aux États-Unis, étant passé par le Guatemala auparavant sans y avoir déposé ma demande. J’assimile ce verdict mais l’incongruité, l’aberration et l’injustice de ma situation me submergent et m’occultent de toute réaction.
Ma demande sera donc prise en compte au Guatemala, où je recevrai, peut-être, l’asile.
Guatemala. La peur embrasait chacun de mes pas.
Le bureau national d’asile qui me reçoit possède quatre employés, symbole de son inaptitude à étudier de multiples demandes. Alors qu’en 2018 il peinait à traiter les 257 demandes d’asile reçues, 100 000 migrants du Salvador et du Honduras entamaient cette même procédure aux États-Unis. Avec le nouvel accord ces derniers seront redirigés, entre autres, au Guatemala. Comment le pays pourra-t-il répondre à une telle augmentation des demandes ?
Pour ma part, d’autres préoccupations m’envahissent. La mort me poursuit toujours. Au terme de ce voyage, elle est désormais plus près de moi que jamais. Les maras et les cartels de drogue ne connaissent pas de frontières. Ils transcendent les délimitations abstraites des nations, constituant des «États parmi les États». Dépourvu de tout, armé d’illusions, mes chances de m’extraire de la pauvreté se voient de nouveau réduites. Car au Guatemala, la pauvreté est plus accrue encore qu’au Salvador : près de la moitié de la population vit ici en dessous du seuil de pauvreté. C’est donc un pays à feu et à sang, duquel 17 000 personnes ont tenté de s’échapper vers les États-Unis en 2018, qui est considéré capable de me protéger du même enfer qui fait fuir son peuple.
Désillusion. La peur m’embrassait de ses bras.
Je deviens à mon tour un de ces spectres coupés de passé et sans destin. J’ai traîné mon âme vagabonde dans ce voyage toponymique qui se révèle sans avenir. Succombant à ma fatalité, aliéné, j’erre désormais le cœur vide et sans espoir.
